Les défis environnementaux et sanitaires du XXIe siècle obligent à repenser en profondeur nos usages technologiques, la gestion des ressources naturelles et les moyens de protection de la santé publique et de l’environnement dans le cadre « Une seule santé ». Trois problèmes illustrent cette interdépendance : la pollution généralisée par des familles de polluants (pesticides, plastifiants, substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)…), la raréfaction des ressources en eau douce au regard des besoins dans le contexte du changement climatique, et les risques épidémiques rappelés par l’émergence de la pandémie COVID-19.
Pollution de l’environnement par les PFAS : de la performance industrielle aux « polluants éternels »
Les PFAS, une vaste famille chimique de plus de 10 000 composés fluorés utilisés depuis les années 1940 dans des secteurs stratégiques (énergie, santé, électronique, textile…), ont transformé nos sociétés par leurs propriétés uniques : résistance chimique, thermique, imperméabilité et faibles frottements. S’ils sont devenus indispensables à certains secteurs, leur stabilité chimique provoque leur persistance planétaire (eaux, sols, air, organismes vivants) avec une toxicité avérée chez l’humain et l’animal. Certaines petites molécules PFAS (PFOA, PFOS, PFHxS, TFA…) migrent dans la chaîne alimentaire, franchissent les barrières biologiques et s’accumulent dans les tissus vivants, avec des effets documentés sur les cancers, troubles endocriniens, immunitaires et reproductifs. Des demi-vies biologiques pouvant atteindre 27 ans témoignent d’une imprégnation durable. La généralisation du terme « polluants éternels » doit cependant être nuancée au vu de la diversité de la famille PFAS. Certains diffusent vers l’environnement et, par contre, des polymères sont très inertes, ce qui appelle une approche différenciée et technologique de leur gestion.
Face à la gravité de la pollution, des réglementations émergeant à l’échelle européenne et internationale visent à interdire ou restreindre les usages PFAS, avec des priorités dictées par la balance bénéfices/risques : bannissement des usages non-essentiels, contrôle industriel, hiérarchisation selon la toxicité, et développement de filières de collecte et destruction à haute température, cette dernière garantissant une élimination sans rejets secondaires.
Les eaux sont très concernées étant le réceptacle de nombreux déchets et les PFAS représentent un degré majeur des contraintes imposées par la pollution pour la production des eaux potables et l’assainissement des eaux usées. Les enjeux sont donc d’agir pour empêcher la contamination des ressources, restaurer les milieux lorsque cela est possible, financer les traitements complémentaires nécessaires pour la production d’eau potable en zones polluées et investir dans le traitement des eaux usées, les boues d’épuration. Il convient aussi de développer les filières de collecte et de destruction garantie des déchets contenant des PFAS.
Crise quantitative et qualitative de l’eau douce : un besoin de sobriété et d’innovation
En France, la demande en eau a longtemps progressé avec la démographie et l’économie, même si depuis 2000, elle tend à diminuer. Mais en parallèle, les ressources en eau douce, comme dans de nombreux pays, subissent les impacts croissants du changement climatique : augmentation des températures (+1,8°C depuis 1950), croissance de l’évapotranspiration, sécheresses, diminution et variabilité accrue des précipitations estivales, fonte des glaciers, baisse de quantité de neige, et altération des débits de cours d’eau. Les tensions se concentrent au moment où les usages (alimentation humaine, agriculture, industrie, production énergétique…) sont les plus élevés. Les projections annoncent des pénuries récurrentes, notamment dans le sud, avec des étiages plus longs et une qualité des eaux dégradée. À l’échelle nationale, le recours intensif aux eaux souterraines, la croissance du nombre d’arrêtés de restrictions et la multiplication des épisodes de sécheresse appellent à des adaptations de consommation, structurelles et technologiques majeures. Le partage équitable des masses d’aux douces disponibles est un défi croissant et les actions développées doivent intégrer les besoins de protection de la vie aquatique et végétale.
Émergent alors de nouveaux défis : préserver la qualité des masses d’eau, dégradées par les polluants (PFAS, pesticides, plastifiants…), promouvoir la sobriété et l’usage d’eaux dites « non conventionnelles » (eaux usées traitées, eaux saumâtres ou de pluie), anticiper et amortir les crises par la diversification des sources et une gestion territorialisée. Les solutions reposent sur la sobriété (réduction de 10 % des prélèvements d’ici 2030), la lutte contre les fuites des réseaux, l’utilisation des eaux usées traitées dans des conditions contrôlées, le dessalement de l’eau de mer dans certaines régions, la recharge artificielle des nappes et le stockage raisonné. Les forêts, par leur régulation hydrique et climatique, sont un atout à préserver. Ces enjeux dépassent les seules infrastructures et invitent à considérer tout le cycle de vie des technologies mises en œuvre. Parmi les principales solutions :
- Utilisation des eaux usées traitées, déjà courante dans d’autres pays pour l’irrigation ou les usages urbains, encadrée en Europe pour limiter les risques sanitaires et environnementaux par des traitements complémentaires (oxydation, charbon actif, membranes). Bien que marginale aujourd’hui (2,4 % des effluents réutilisés en Europe), elle représente un levier intéressant pour la résilience hydrique.
- Dessalement de l’eau de mer ou d’eaux saumâtres, principalement par osmose inverse ou procédés thermiques. Cette technologie, déjà critique dans plus de douze pays, offre d’immenses volumes d’eau douce mais reste énergivore, génératrice de rejets salins. Son développement est à évaluer selon le contexte local, la disponibilité énergétique et la proximité de la côte et les évolutions de consommation.
- Stockage, rétention et transfert de l’eau par barrages, retenues collinaires, ou recharge artificielle de nappes, permettant d’amortir la saisonnalité et la variabilité accrue du cycle hydrologique. Si ces solutions sont éprouvées et massivement utilisées, leur acceptabilité sociale, leur impact écologique et leur viabilité à long terme doivent être systématiquement évalués et leur développement construit par consensus.
- Nouvelles pratiques agricoles, orientées vers la sobriété hydrique (gestion raisonnée de l’irrigation, sélection variétale, pratiques culturales économes), indispensables pour gérer les conflits d’usages estivaux et assurer la résilience alimentaire.
Ces solutions, nullement universelles, doivent être sélectionnées en fonction des spécificités locales, de l’état des ressources, des usages, mais aussi du contexte économique, énergétique et environnemental. Un dialogue transparent, la formation des parties prenantes à la culture scientifique, et l’anticipation sur plusieurs décennies s’avèrent incontournables pour garantir la soutenabilité.
Épidémiologie des eaux usées : un outil d’étude et de surveillance sanitaire
L’analyse des eaux usées permet un suivi des évolutions de santé des populations. Elle est utilisée notamment pour évaluer la consommation de drogues illicites et a été employée pour le suivi de la diffusion du virus SARS-CoV-2 de la crise COVID. Suivre l’évolution de microorganismes pathogènes dans les réseaux d’assainissement permet d’aider aux procédures de gestions en santé. Cette approche requiert des méthodes de détection sensibles. Les investissements dans la recherche et l’équipement des laboratoires doivent être soutenus pour contribuer à la prévention en santé et l’optimisation des procédures de gestion des crises épidémiques.
Recommandations
- Accélérer le développement et le déploiement de technologies de gestion de l’eau et de traitement des polluants émergents (PFAS, pesticides et métabolites, résidus de médicaments…) selon une approche systémique, territoriale et pluridisciplinaire en aidant notamment les petites communes confrontées à ces défis.
- Hiérarchiser, substituer ou restreindre fortement les usages de substances critiques (PFAS), en priorisant la production et l’emploi de solutions alternatives à faible risque sanitaire ou écologique et les filières de destruction/dépollution.
- Développer les stratégies de gestion des usages de l’eau douce au regard des réductions de ressource notamment par les orientations de sobriété, de partage raisonné, de stockages communs, de réduction des polluants déversés, d’utilisation sécurisée des eaux usées traitées et des eaux non conventionnelles, en renforçant la recherche sur leurs impacts et la standardisation des procédés, tout en privilégiant une logique territoriale.
- Anticiper les mutations hydriques par l’investissement dans le stockage, la rétention, la recharge des nappes, tout en intégrant les contraintes locales et la préservation de la biodiversité.
- Former, informer et impliquer les acteurs publics, privés et les citoyens dans une culture de sobriété, d’innovation et de vigilance transparente et partagée sur l’eau et les risques sanitaires liés aux polluants émergents et microorganismes pathogènes.
- Renforcer la coopération internationale et la veille réglementaire pour harmoniser les standards, faciliter les échanges de bonnes pratiques et garantir une adaptation rapide face aux évolutions globales.
- Développer l’innovation en épidémiologie des eaux usées et le développement des bioessais pour l’évaluation qualitative des risques sanitaires liés à la pollution des eaux.
Ce texte résulte d’une synthèse de rapports de l’Académie des technologies générée par des IA génératives. Cette version a été relue et révisée par les auteurs des rapports.




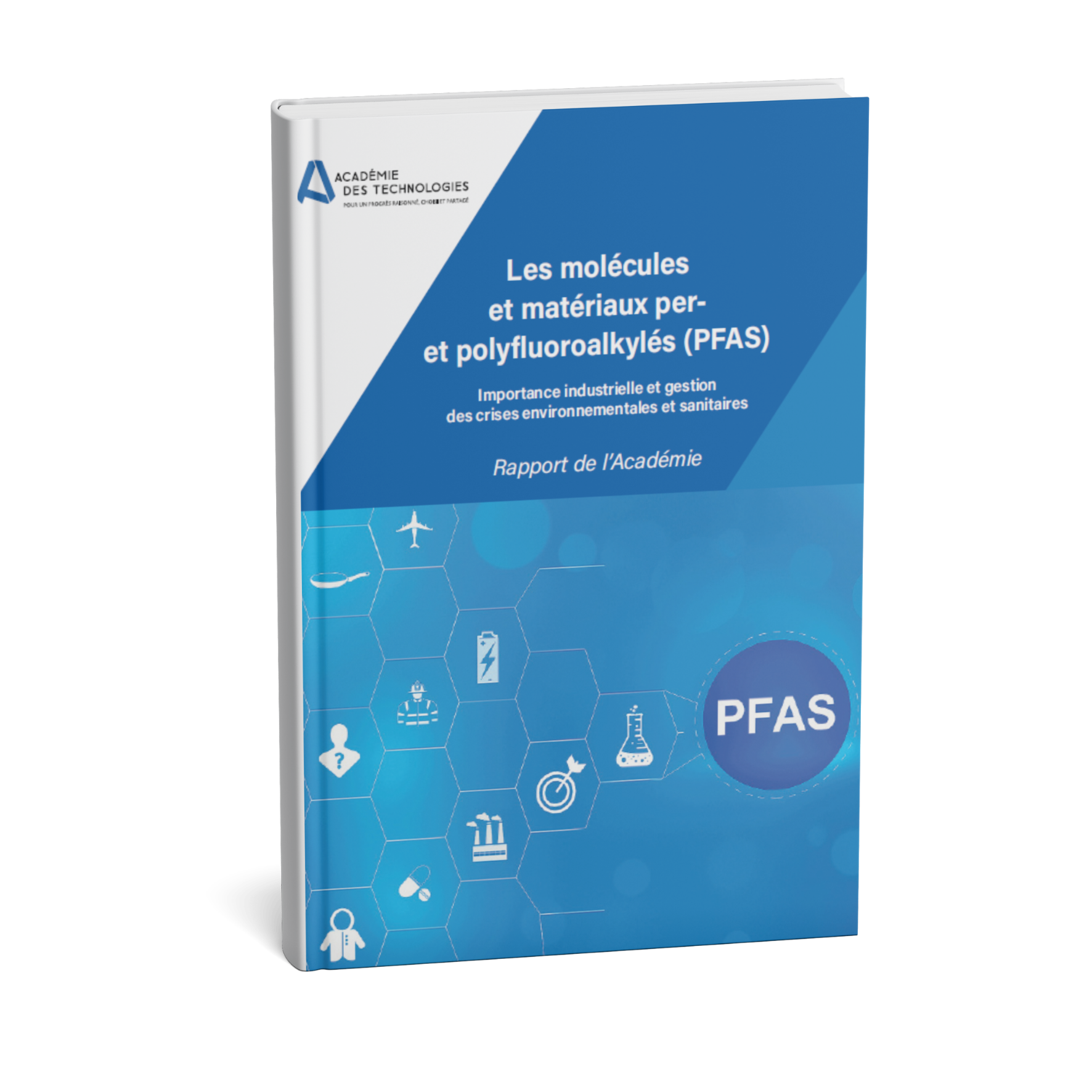
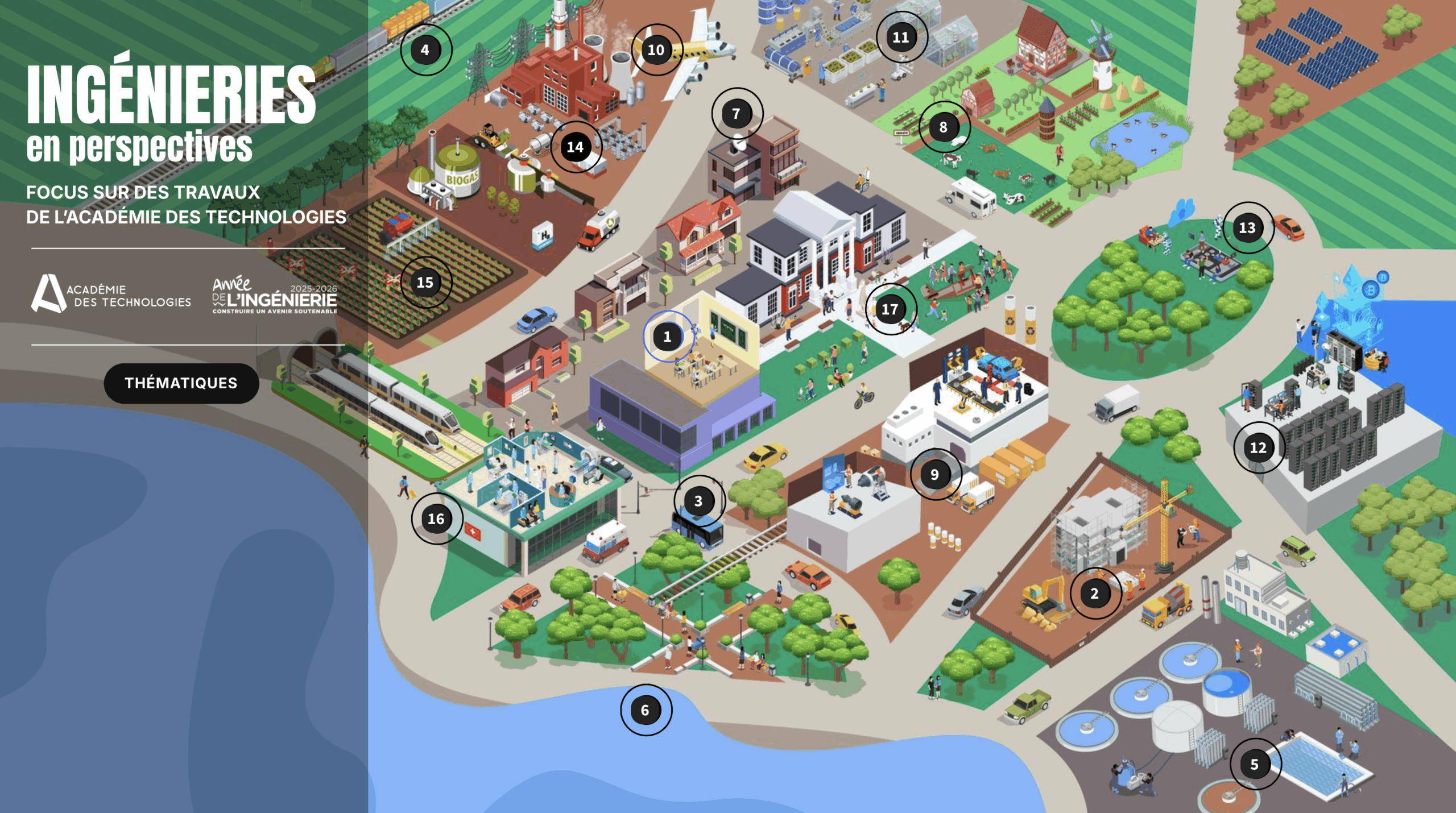
L’espace commentaire