Les NTG, regroupant notamment les outils d’édition comme CRISPR-Cas9, représentent à la fois une avancée scientifique majeure et un défi sociétal. Leur capacité à transformer profondément l’agriculture, plus rapidement et précisément que les méthodes classiques, offre des opportunités inédites pour répondre à des questions aussi diverses que l’adaptation au changement climatique, la réduction des intrants chimiques, ou encore la diversification des pratiques agricoles.
Un contexte scientifique et sociétal complexe
L’histoire des biotechnologies végétales est marquée par une évolution rapide, de la création in vitro de mutants à la production d’organismes génétiquement modifiés (OGM), jusqu’aux NTG qui, avec la modification de zones précises du génome, repoussent les frontières du possible. La diffusion des OGM depuis les années 1990 a montré à la fois la puissance du génie génétique et ses limites : les créations de variétés commerciales ont été concentrées sur quelques espèces de grande culture (maïs, colza, soja, coton) et sur un petit nombre caractères (tolérance aux herbicides, résistance à des insectes), au prix d’une dépendance accrue aux intrants chimiques et d’un risque d’appauvrissement de la biodiversité cultivée. En Europe, le débat public s’est structuré autour de la méfiance envers les institutions chargées d’évaluer les risques, de la brevetabilité du vivant, de l’information des consommateurs (étiquetage) et de la volonté d’encadrer strictement l’innovation.
Les NTG offrent des potentiels considérables : accélération de la création variétale, adaptation aux stress biotiques et abiotiques, contribution à la transition agroécologique, amélioration des qualités nutritionnelles des plantes. Les NTG, selon leur mode d’utilisation et les régulations qui seront mises en place, pourraient reproduire ou non les dynamiques constatées pour les OGM, caractérisées par une forte concentration géographique et industrielle, et la réduction de la diversité cultivée. Les risques de mutations hors cible, les incertitudes sur les effets systémiques et les usages émergents soulignent l’importance d’une vigilance scientifique et sociétale permanente.
Ces opportunités offertes par les NTG s’accompagne ainsi d’enjeux de société, qu’il s’agisse de questions sur la souveraineté alimentaire, de débats sur l’acceptabilité sociale, de la question épineuse de la propriété intellectuelle et de la place de la recherche publique, ou encore des tensions autour des réglementations nationales et internationales.
Enjeux réglementaires et évaluations
L’Union européenne, très prudente, assimile toute culture issue de NTG à un OGM, sauf exceptions limitées. D’autres pays (États-Unis, Japon, Brésil) privilégient une approche basée sur la nature du trait modifié. Cette diversité des cadres impose une réflexion approfondie sur l’encadrement réglementaire, la traçabilité, le suivi environnemental et la prise en compte des impacts socio-économiques à moyen et long terme. S’interroger sur les choix d’évaluation (« par la méthode » vs « par le trait »), sur la transparence de la chaîne de valeur, sur le dialogue entre acteurs scientifiques, institutionnels et citoyens, devient indispensable pour orienter l’innovation au service de l’intérêt général. Par ailleurs, les divergences d’approches règlementaire portent le risque de marginalisation européenne et compliquent les échanges commerciaux.
L’économie de l’innovation en matière de NTG révèle des tensions sur le rôle central de la propriété intellectuelle et de la concentration du secteur semencier, qui risquent de limiter l’accès des PME et des chercheurs publics à ces technologies. Pour pallier ces risques, un soutien massif à la recherche publique et la mise en place de mécanismes favorisant un accès équitable (licences obligatoires, coopération internationale) semblent s’imposer, de même qu’une évaluation précise et indépendante de la contribution concrète des NTG aux transitions agricoles et alimentaires.
Vigilance, traçabilité, adaptation : les clés de l’acceptabilité ?
Les NTG peuvent être mises au service de l’agroécologie, en renforçant la diversité des espèces cultivées, en facilitant les cultures associées, en améliorant les interactions plantes-microbiotes et en réduisant le recours aux pesticides. Toutefois, leur efficacité est conditionnée par une approche systémique, intégrant agronomie, écologie et sciences sociales. Leur intérêt ne réside pas seulement dans la création de « plantes miracles », mais dans la possibilité d’accompagner une transformation plus large des systèmes agricoles, conciliant productivité, durabilité et résilience. La biovigilance et la « sociovigilance » sont donc des dispositifs essentiels pour accompagner le développement des NTG après leur mise sur le marché afin d’identifier, documenter et corriger, le cas échéant, les impacts sanitaires, environnementaux et sociaux. Le suivi doit être transparent, pluraliste et nourri de toutes les expertises. Un régime différencié d’évaluation et de traçabilité, proportionné au type de modification génétique et à son impact potentiel, permet d’optimiser la sécurité tout en évitant une bureaucratisation excessive qui entraverait l’innovation, surtout pour les PME et les productions alternatives.
Recommandations
- Mettre en œuvre une évaluation différenciée et adaptée, via une procédure d’évaluation européenne des variétés NTG, distinguant les modifications analogues à des mutations naturelles et accordant des exemptions ou procédures simplifiées selon les cas.
- Renforcer la recherche publique et garantir un système de licences équitables, notamment pour les PME et pour les espèces dites « orphelines ». afin de limiter la concentration excessive des droits.
- Mettre en place des dispositifs de biovigilance et sociovigilance, associant scientifiques, agriculteurs et société civile, afin de suivre les impacts à long terme.
- Adapter la traçabilitédes plantes issues des NTG (registre public, recensement), garantissant la transparence sans freiner inutilement l’innovation.
- Orienter les NTG vers la transition agroécologique, en les intégrant dans des approches systémiques de diversification, de réduction des intrants et d’adaptation au changement climatique.
- Contribuer à l’harmonisation internationale des réglementations, et, en Europe, adapter ou compléter la directive 2001/18 pour un cadre adapté aux spécificités des NTG et de leurs usages.
Ce texte résulte d’une synthèse de rapports de l’Académie des technologies générée par des IA génératives. Cette version a été relue et révisée par les auteurs des rapports.



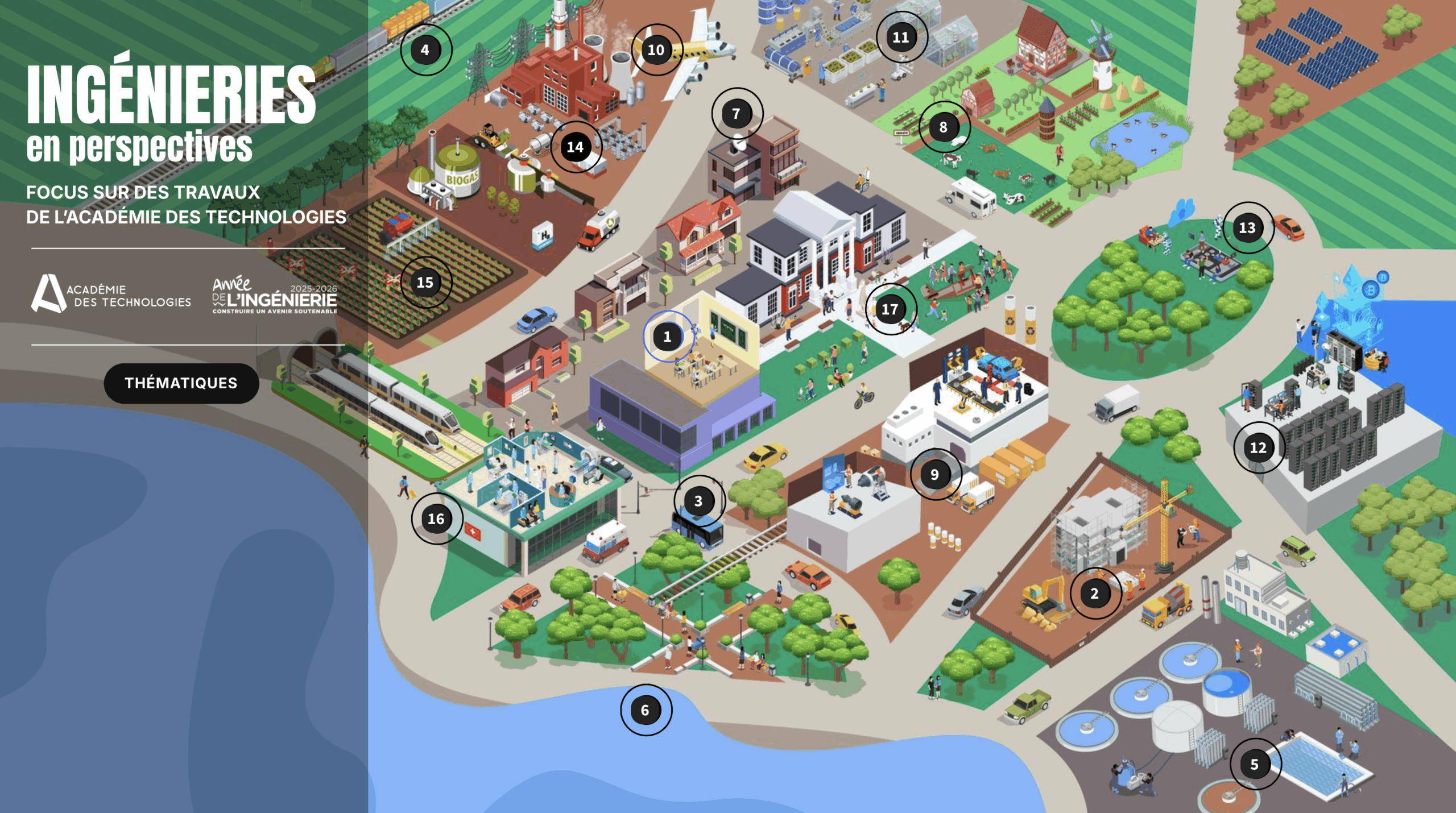
L’espace commentaire