Dans un monde marqué par des innovations rapides et traversé de crises multiples, la culture scientifique et technique devient une nécessité. Elle constitue une clé de compréhension pour analyser les transformations en cours, juger de la pertinence des choix collectifs et donner envie de participer à la vie citoyenne.
L’Académie des technologies invite à développer une culture technologique vivante, capable de susciter l’intérêt porté aux changements en cours, d’éveiller l’esprit critique et de donner du sens au progrès.
Les objets techniques : matérialité, durée et invisibilité
L’Académie des technologies insiste sur la nécessité d’une attention accrue portée aux objets techniques. Loin d’être neutres, ils incarnent des choix de société. Chaque smartphone, voiture ou équipement médical est le produit de chaînes industrielles mondialisées, d’extractions minières coûteuses en énergie, de procédés de transformation et de logistique complexes. Leur « fin de vie » n’est jamais définitive : ils persistent sous forme de déchets, de matériaux recyclés, ou de pollutions invisibles. La culture scientifique et technique doit donc rendre perceptible cette matérialité cachée. Elle doit aussi montrer que la technique n’est jamais complètement « dématérialisée » : le numérique, souvent perçu comme immatériel, repose sur des infrastructures lourdes, des serveurs énergivores et des métaux rares. Développer une sensibilité technique, c’est apprendre à questionner le cycle de vie des objets et à assumer notre responsabilité collective vis-à-vis de leur avenir.
Les imaginaires et les récits du futur
La technique n’existe pas seulement dans les laboratoires ou les usines : elle vit aussi dans nos imaginaires. Les récits véhiculés par la littérature, le cinéma ou les médias façonnent notre rapport aux innovations, en oscillant entre fascination et crainte. Ces imaginaires influencent fortement l’acceptabilité sociale : une technologie entourée de récits catastrophistes sera perçue comme menaçante, tandis qu’un imaginaire positif peut nourrir l’adhésion. Cultiver une culture scientifique et technique, c’est aussi travailler sur ces représentations, donner une place à la créativité et au débat symbolique, afin de construire une vision partagée du progrès.
L’acceptabilité sociale : comprendre plutôt que contraindre
Les débats sur le nucléaire, les OGM, les pesticides, la 5G ou les grands projets d’infrastructures montrent que l’acceptabilité sociale ne peut être réduite à une opération de communication. Elle est un processus dans lequel se rencontrent valeurs, mémoires collectives, intérêts économiques et visions du futur. L’acceptabilité évolue au fil du temps : un projet peut d’abord être rejeté, puis toléré ou adopté, à mesure que ses effets se précisent ou que des dispositifs d’accompagnement se mettent en place. Cette dimension temporelle est cruciale : les sociétés ne réagissent pas seulement aux projets présents, elles les évaluent aussi à la lumière des expériences passées et des attentes pour l’avenir. Une culture scientifique et technique consciente de ces dynamiques permet de comprendre les controverses comme des moments d’apprentissage collectif plutôt que comme des obstacles.
L’appropriation des technologies : un processus social et culturel
Loin d’être une simple adoption d’outils, l’appropriation technologique résulte d’une dynamique complexe où se croisent inventeurs, usagers, avec leurs imaginaires et contraintes matérielles. Chaque innovation combine des éléments préexistants, des besoins exprimés et des représentations collectives. Les objets ne sont pas seulement utilisés : ils sont interprétés, transformés, parfois détournés. Cette appropriation comporte une dimension identitaire et culturelle : les technologies influencent nos façons de travailler, de communiquer, de nous déplacer, mais aussi notre rapport au temps et à l’espace. Comprendre ces processus (un volet de la culture scientifique et technique) permet de sortir de l’illusion d’un progrès linéaire et uniforme, et de saisir combien l’innovation est toujours située, discutée et réinterprétée.
Sobriété : une exigence partagée et désirable
La sobriété n’est pas un frein au progrès mais une nouvelle manière de le concevoir. Elle implique d’utiliser les ressources avec discernement, d’éviter le gaspillage et de privilégier les innovations réellement utiles. Contrairement à l’idée d’un sacrifice individuel, la sobriété repose sur un effort partagé entre citoyens, entreprises et pouvoirs publics. Elle suppose une révision des modes de production, des infrastructures et des comportements quotidiens. Elle peut même devenir une source d’innovation en stimulant la créativité et en orientant la recherche vers des solutions économes, réparables et durables. En faire une dimension de la culture scientifique et technique permet d’échapper à l’opposition stérile entre croissance illimitée et décroissance imposée. La sobriété devient alors un horizon positif, qui relie efficacité, justice sociale et durabilité écologique.
Temporalités, expertise et participation citoyenne
Les choix technologiques se heurtent aux décalages entre la rapidité des innovations, l’inertie structurelle des institutions et les rythmes de la société. Dans ce contexte, l’expertise scientifique est indispensable mais insuffisante. Elle doit être pluraliste, indépendante et transparente pour être crédible. L’expérience citoyenne, de son côté, apporte un savoir d’usage et une légitimité démocratique. Les dispositifs de concertation ou de participation publique n’ont de valeur que s’ils sont sincères, ouverts et réellement influents. Sinon, ils alimentent la méfiance et le rejet. Inscrire ces dimensions dans une culture scientifique et technique, c’est former des citoyens capables de comprendre la complexité des choix, de dialoguer avec les experts et de participer activement à l’orientation des innovations.
Vers une culture technologique démocratique et responsable
La position de l’Académie des technologies est claire : au-delà de l’Ecole, la culture scientifique et technique doit irriguer la société tout entière notamment par l’intermédiaire des musées techniques, des centres de culture scientifique, technique et industrielle, de diverses structures de médiation, des médias. Elle aide à comprendre l’origine et le devenir des objets, à évaluer les impacts des innovations, à penser la sobriété, à analyser l’acceptabilité et à construire des imaginaires collectifs positifs. Elle constitue une condition pour renforcer la démocratie et rendre les transitions écologiques et sociales plus justes. Elle doit éviter les deux écueils symétriques : la croyance aveugle dans la toute-puissance technologique et le rejet global de toute nouveauté. Entre ces extrêmes, une culture technologique critique mais constructive aide à la préparation d’un avenir soutenable.
Recommandations
- Renforcer l’éducation scientifique et technique en intégrant l’histoire, la matérialité et la durée de vie des objets.
- Promouvoir la sobriété comme valeur positive, en articulant innovation, justice sociale et durabilité.
- Encourager la réappropriation des techniques, par la pratique de la réparation, le recours à la maintenance préventive et le partage des expériences dans des espaces collaboratifs.
- Garantir une expertise indépendante et pluraliste, accessible et compréhensible pour tous.
- Veiller à une répartition équitable des coûts et bénéfices des transitions technologiques et environnementales.
- Renforcer la participation citoyenne aux débats et aux décisions relatives aux choix technologiques majeurs.
Ce texte résulte d’une synthèse de rapports de l’Académie des technologies générée par des IA génératives. Cette version a été relue et révisée par les auteurs des rapports.



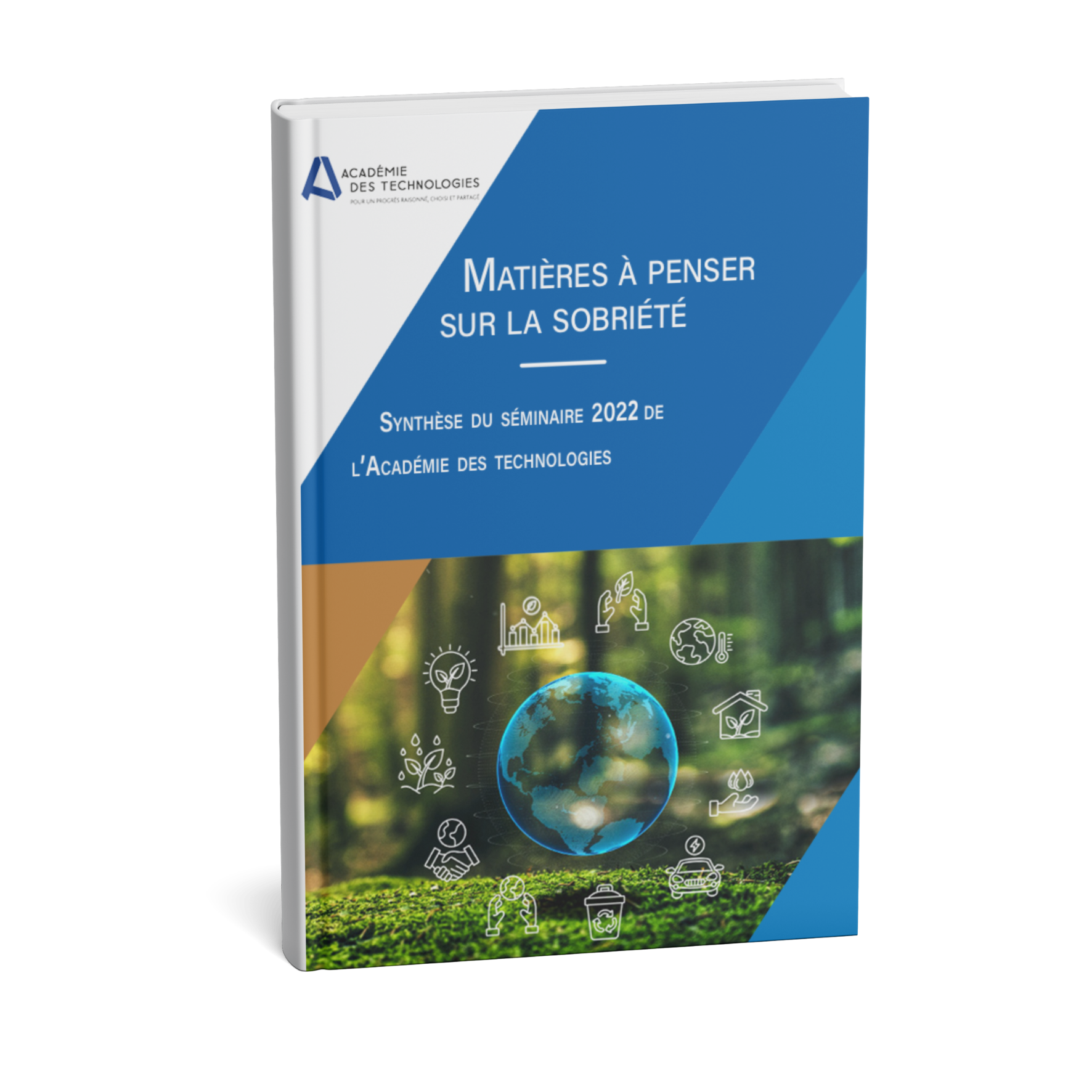
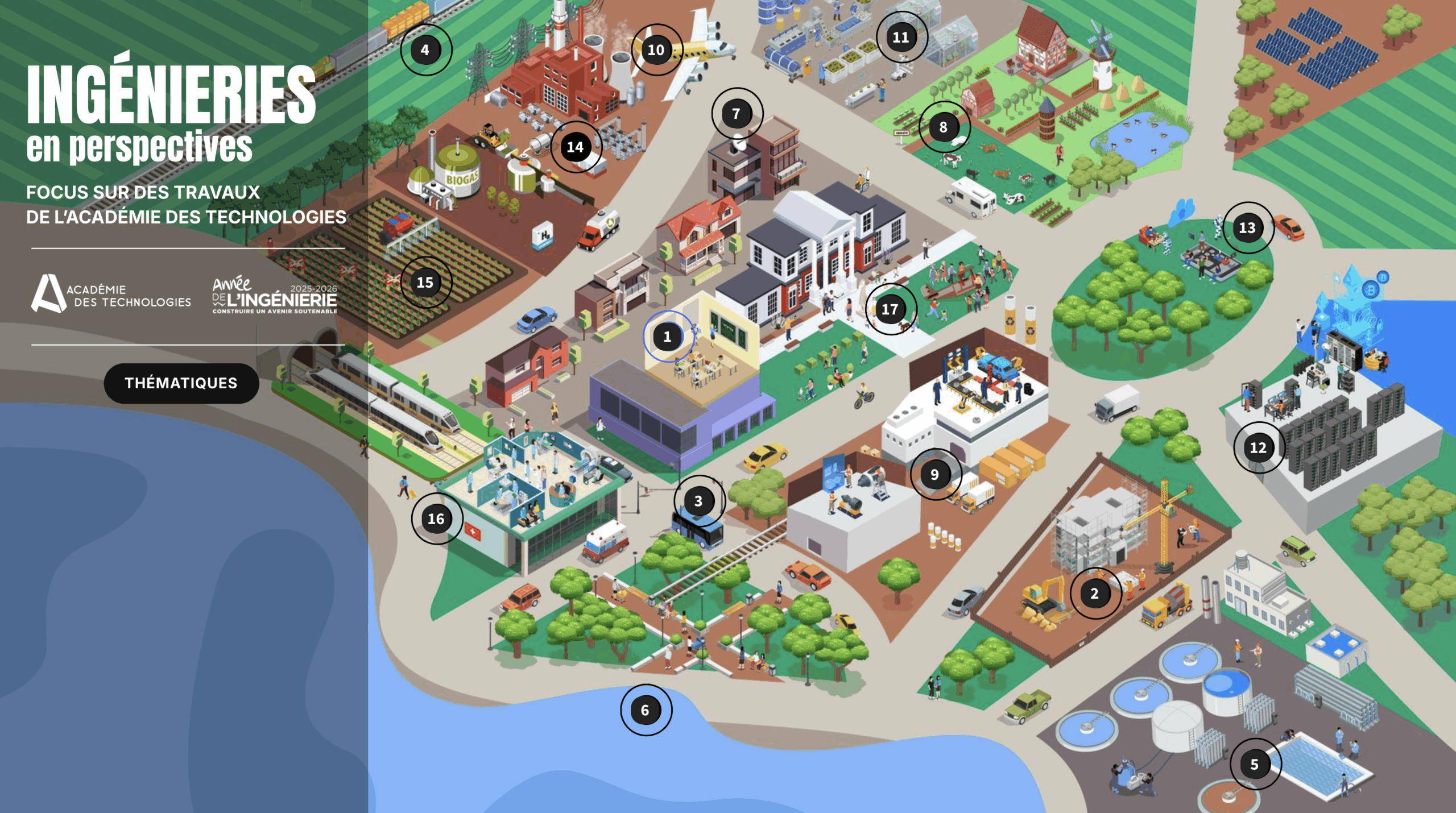
L’espace commentaire